... Cet article est uniquement réservé aux planteurs adhérents. Déjà adhérent ? Se connecter...
ACTUALITÉS & INFOS ADHÉRENTS
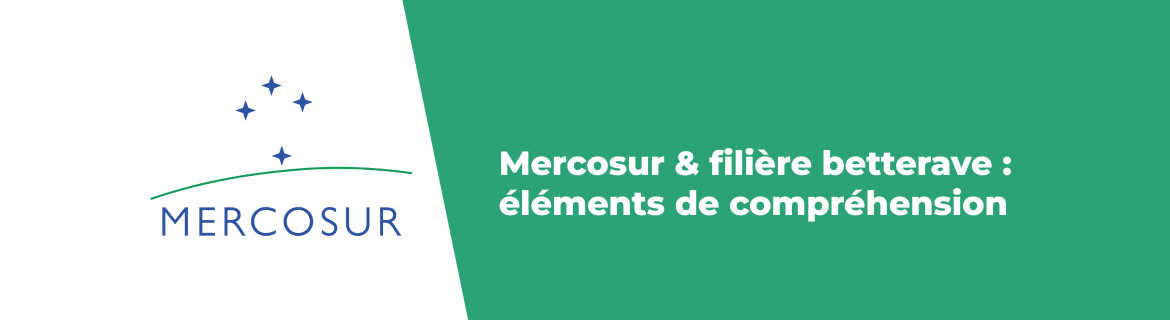
Calendrier
L’accord entre l’Union européenne et le Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) était négocié depuis 1994 ; les négociations ont abouti en juin 2019, et la ratification était, depuis, en suspens. A la suite des annonces de la Commission européenne en septembre 2025, il pourrait s’appliquer dès 2026.
Ce que l’accord contient pour notre filière
Cet accord donne au Brésil un accès au marché européen, pour notre secteur :
190 000 t de sucre à droit de douane nul :
► Ce volume ne sera probablement pas importé en France, mais sera importé dans les bassins déficitaires où on ne peut pas cultiver de betterave sans irrigation (Espagne, Italie…), en remplacement de sucre français. Aujourd’hui, 1/3 du sucre consommé dans ces pays est du sucre français ; il sera remplacé par du sucre brésilien à hauteur 190 000 t : c’est l’équivalent de la production d’une usine française.
► Ce volume de 190 000 t, à l’échelle communautaire, est présenté comme faible : soulignons qu’il vient en plus de l’existant : plus de 1,5 Mt dans le cadre d’accords de libre-échange (Afrique du Sud, Colombie, Ukraine, pays des Balkans…), et aucune limite pour les pays les plus pauvres (Eswatini, Maurice…).
►Dans le détail technique, ce contingent se compose de 180 000 t de sucre brésilien (auparavant taxé à un droit, déjà réduit, de 98 €/t) et de 10 000 t de sucre brut à des fins de raffinage, sans droits de douane, du Paraguay exclusivement (aujourd’hui taxé au droit normal de 339 €/t).
8,2 Mhl de bioéthanol à droit de douane réduit ou nul
► Ce volume d’éthanol à droit réduit ou nul représente environ 12% de la production européenne, ou l’équivalent de ce que produit la France à partir de ses betteraves.
► Dans le détail, il s’agit de 450 000 t d’éthanol (environ 5,7 Mhl) sans droit de douane, à utilisation exclusivement industrielle et de 200 000 t d’éthanol (environ 2,5 Mhl) à droits réduits au tiers de la valeur, pour tout usage, y compris carburant.
Ces deux concessions cumulées (sucre et éthanol) accordées par l’Union européenne représentent la production de 50.000 ha de betteraves, soit 1/8ème des surfaces françaises de betteraves.
Ce que l’accord ne contient pas
Pour mémoire, l’accord ne comprend :
► Aucun encadrement relatif aux produits phytosanitaires utilisés pour produire la canne à sucre au Brésil. Or, à date, au moins 40 substances actives sont autorisées au Brésil, mais interdites dans l’Union (certaines depuis 2007 !), et notamment ceux de la catégorie des néonicotinoïdes, devenu emblématiques sur l’Union européenne. Le sucre étant un produit pur, on ne pourra jamais savoir les conditions de production du sucre importé…
► Aucune demande de traçabilité relative aux OGM, alors que le Brésil autorise, depuis 2017, la culture de canne transgénique.
► Aucun encadrement sur le droit social dans les plantations de canne. Rappelons à ce titre que moins du tiers des surfaces brésiliennes de canne à sucre est cultivé par des planteurs indépendants, les deux-tiers étant cultivés par des groupes industriels. Les concessions de volumes ne sont donc pas faites majoritairement au profit d’agriculteurs brésiliens, mais au profit de groupes industriels.
Qu’a-t-il été annoncé le 3 septembre 2025 ?
La politique commerciale de l’Union européenne est du seul ressort de l’Union, et chaque pays membre lui a délégué sa compétence : c’est la base même de l’Union européenne (article 3 du Traité Fondateur de l’Union Européenne).
Mais les accords, depuis plusieurs années, vont plus loin que les simples accords commerciaux. Ils traitent, par exemple, d’engagement vers le développement durable ou d’engagement à des investissements. Dans ces conditions, l’accord, initialement, devait être ratifié également par chaque Etat membre, individuellement.
Réalisant que certains Etats membres ne ratifieraient pas l’accord, la Commission a annoncé, le 3 septembre, la scission de l’Accord en deux parties. Cela signifie que l’accord est coupé en deux parties :
► La partie exclusivement commerciale (les contingents à droits de douane réduits), du seul ressort de l’Union : lui seul peut n’être ratifié que par la Commission européenne, le Conseil et le Parlement européen.
► Et le reste de l’accord, qui, lui, nécessitera, d’être ratifié par chaque Etats membres : c’est la partie ‘non-commerciale’.
Et demain ?
La partie commerciale doit donc être désormais ratifiée par :
► la Commission européenne : c’est chose faite.
► le Conseil : à ce jour, le nombre de pays ouvertement contre (France, Pologne, Autriche et Pays-Bas) risque d’être insuffisant, au sein du Conseil, pour parvenir à s’opposer à cette ratification : la minorité de blocage représente au moins 4 États membres représentant ensemble plus de 35 % de la population de l’UE.
► Le Parlement européen, très divisé à ce sujet, sera donc, probablement, décisionnaire.
Concernant la partie non-commerciale, elle doit être désormais validée par les Etats membres. On fera remarquer que, une fois que les contingents s’appliqueront, l’intérêt de s’y opposer devient absurde… ! C’est néanmoins ce qui est le cas pour l’accord avec le Canada : la partie commerciale s’applique depuis 2017, alors qu’il n’a jamais été ratifié par les Etats membres (le Sénat français a même voté contre en 2024…).
L’accord contient-il des clauses de sauvegarde ?
La Commission européenne met en avant la mise en place de clauses de sauvegarde. Pour faire simple, il s’agit de suspendre les flux si un préjudice était démontré.
Ces clauses n’ont jamais été opérantes dans le cas des accords précédents : il est illusoire de pouvoir démontrer un lien de cause à effet direct avec un simple accord, qui n’agit qu’en superposition de tous les autres, et leurs éventuelles activations n’ont lieu qu’après le préjudice observé !
Rappelons que, dans le cas du Brexit, un fond d’indemnisation d’1Md€ avait été promis ; la France a eu beau avoir perdu le débouché de 200 000 t de sucre annuellement, le lien de cause à effet, dans un contexte de crise sanitaire de 2020, n’a jamais pu être démontré…
Autres actualités
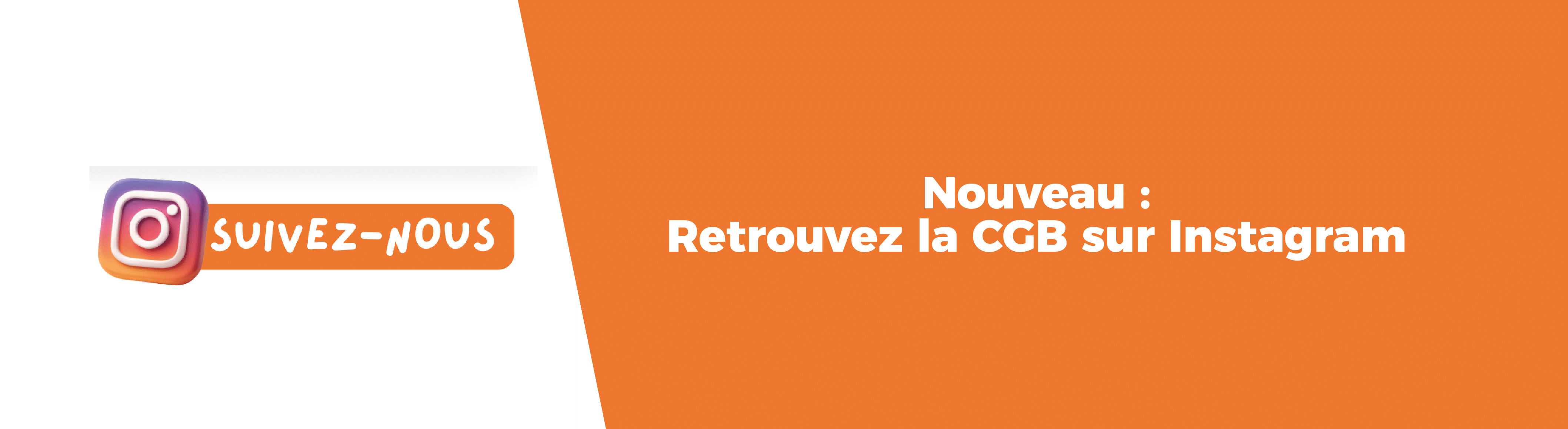
Afin de renforcer la visibilité de nos actions, votre syndicat est désormais présent sur...
Pourquoi s'inscrire
à la newsletter ?
Suivre l'actualité
Rester informé(e)
Partciper aux
actions de la CGB





